Ce mois-ci, j’ai plongé dans des univers littéraires et cinématographiques sombres et épineux, où le cœur de femmes qui me ressemblent ont été mis à mal… et j’ai commencé mon visionnage des films de Noël, oui, déjà.
J’aurais aimé commencer cette newsletter en vous disant que j’avais adoré Wicked (après tout, j’ai eu de vrais beaux frissons devant le premier), mais malheureusement, ce ne sera pas le cas… C’est drôle comme le cinéma (l’art, en général) crée des attentes et vous emmène à des endroits imprévus ; les choses que vous vouliez aimer vous laisser de marbre mais le hasard d’une rencontre (livresque, filmique) imprévue vous bouleverse. C’est un peu ce qui s’est passé pour moi ce mois-ci, au gré de lectures vraiment marquantes et vraiment difficiles, et d’une nouvelle série Netflix qui m’a pas mal plu.
Des femmes qui brûlent
En novembre, j’ai beaucoup bouquiné (temps pluvieux oblige) et j’ai lu deux œuvres qui m’ont beaucoup marquée. La première, c’était le roman Penance d’Eliza Clark, que mon amie Axelle (qui m’avait déja prêté École pour filles le mois dernier) m’a prêté (merci Axelle !!!). J’avais déjà entendu parler d’Eliza Clark grâce à Tiktok, ma source d’information littéraire principale, et de son roman Boys Parts, mais jamais de Penance, son second projet, qui a reçu un peu moins d’attention médiatique. C’est bien dommage, car je crois qu’il s’agit d’un des romans qui m’a le plus tourneboulée ces dernières années.
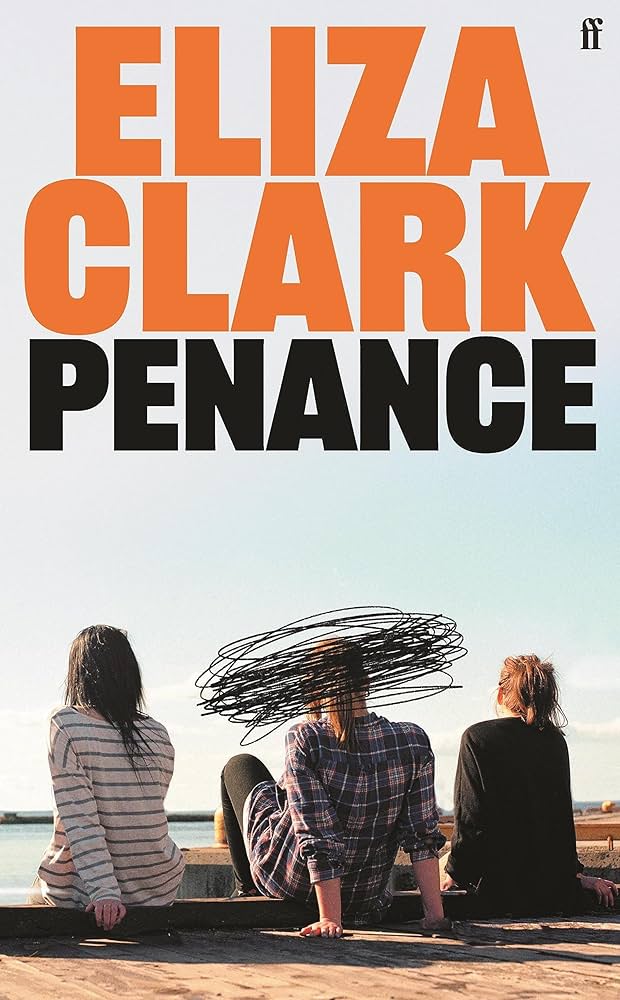
Penance raconte une histoire difficile, celle d’une adolescente britannique de seize ans assassinée par ses amies du lycée, qui la séquestrent et lui mettent le feu. Quelques années plus tard, ce fait-divers traumatisant est exhumé et interrogé par un auteur de true crime sur le déclin, qui décide de lui consacrer le sujet de son nouvel ouvrage. C’est cette œuvre que nous met Eliza Clark entre les mains, un vrai-faux roman policier qui joue avec les seuils narratifs ; un faux auteur nous raconte un vrai fait-divers, à moins que ce soit l’inverse, à moins que…
J’ai d’emblée été séduite par ce jeu entre fiction et vérité, qui interroge en creux notre soif de sang et rapport à la réalité. Eliza Clark, qui a confié dans une interview pour Dazed être elle-même une consommatrice de true crime (« I don’t think you’re an awful person if you’re interested in true crime. It is interesting. I’m interested in it » explique-t-elle), vient ici gratter à un endroit où ça démange, et nous force à regarder bien en face notre appétit pour les (vraies ? fausses ?) histoires glauques.
C’est un sujet qui ne me laisse pas indifférente, moi qui adore les films d’horreur, et qui réfléchit souvent au plaisir voyeuristique du cinéma de genre et du gore. Je n’ai jamais franchi l’étape du true crime néanmoins, parce que c’est un peu trop glauque (entendez : réel) pour moi, mais dans le cadre d’un article que j’avais écrit cet été pour Trois Couleurs sur notre fascination pour les adolescentes qui vont mal à l’écran, j’avais lu ce très bon papier de Clare Clarke dans The Irish Times sur notre obsession culturelle pour les belles jeunes filles mortes, et c’est une idée qui m’est restée en tête depuis. Nous vivons clairement dans un monde où, de la fiction à la réalité, nous nous repaissons des cadavres encore chauds de (très) jeunes femmes, qu’elles meurent sous nos yeux dans les thrillers et les tableaux que nous regardons, ou dans nos oreilles, via les épisodes de podcasts consacrés à leur disparition. Pourquoi aimons-nous tant les voir mourir, pourquoi les avons nous élevées au rang de beautés languides et sacrificielles ? Penance nous happe dans son récit grâce à notre fascination pour le morbide, mais la violence des faits qu’il imagine est si crue qu’elle nous laisse seul.e face à nous-même, et nous force à interroger cet appétit malsain.

Outre une mise en abyme du glauque, Penance propose aussi une plongée captivante dans l’univers des adolescentes, et s’intéresse de façon assez inédite au bullying féminin (un thème qui m’intéresse beaucoup mais que je croise assez rarement en littérature, à part dans le très bon Cat’s Eye de Margaret Atwood, une lecture qui commence à dater un peu. Si vous avez des recommandations…). Plutôt qu’une étude de surface manichéenne, Eliza Clark décortique les liens parfois ambivalents qui se tissent entre les jeunes filles, et la façon dont les cartes entre elles peuvent être rebattues à n’importe quel moment. C’est un portrait sans fard de la violence lycéenne, des mécanismes de sape morale, de dévalorisation, d’exclusion insidieuse qui font rage à l’école, et moi qui, à 28 ans, décrit encore le collège comme “une fosse aux lions”, je suis toujours heureuse de tomber sur des histoires qui regardent cette brutalité particulière bien en face.
Penance se déroulant en plus dans les années 2010, période à laquelle j’étais moi-même au lycée, c’était d’autant plus facile de se projeter et de s’identifier aux personnages ; le livre dresse d’ailleurs un portrait particulièrement intéressant du fangirling et de tumblr, deux phénomènes qui, en dépit de l’impact déterminant qu’elle ont eu sur la culture de cette époque-là, sont souvent absents des fresques rétrospectives qui en sont faites. Eliza Clark, elle, choisit de les placer au centre de son intrigue, et dépeint assez justement les espace alternatifs (mais bien réels) qu’étaient les fandoms et tumblr pour les adolescentes des années 2010, un endroit où se négociait très sérieusement leurs aspirations, leurs appartenances communautaires et in fine, leur identité. Pour ma part, en tant qu’ex-utilisatrice intensive de tumblr, croiser les mots dashboard, notes et reblog au détour son texte a été une expérience extrêmement étrange, à mi-chemin entre la conscientisation du temps qui passe et la madeleine de Proust.

L’usage dérangeant et subversif que ses personnages ont de la plateforme ne correspond pas au mien, qui était beaucoup plus sage et se limitait à des stills aesthetically pleasing de films et de photos soft grunge, mais c’était satisfaisant de lire enfin un livre où les réseaux sociaux étaient écrits par quelqu’un de mon âge (Eliza Clark a 31 ans) et non pas par un auteur.ice boomer qui cherchait simplement à dénoncer leur vacuité. Bref, pour toutes ces raisons, je pense que Penance va occuper une place de choix sur mes étagères mentales, et ce, pour très longtemps. Si seulement HBO pouvait l’adapter en série…
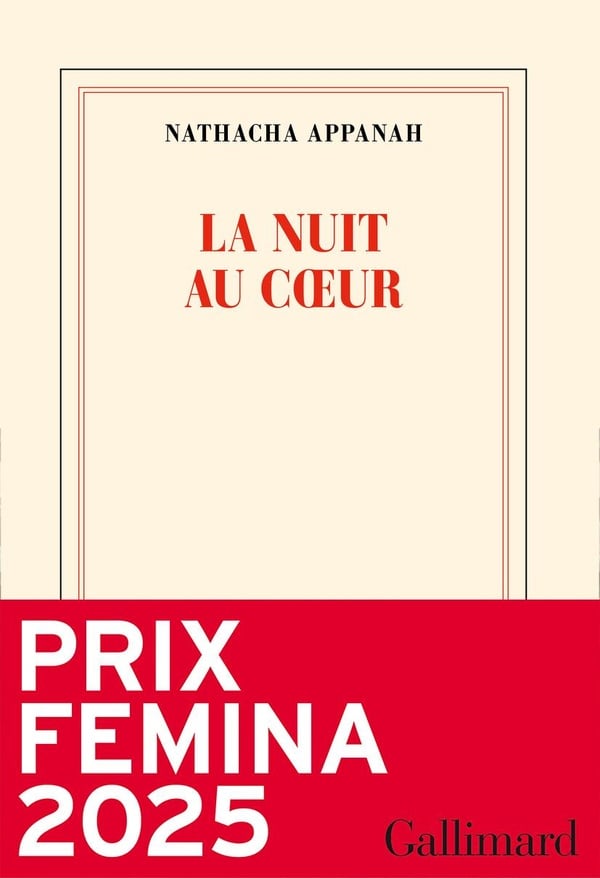

Comme un fil rouge détraqué, mes lectures m’ont ensuite menée du côté du dernier roman de Nathacha Appanah, La nuit au cœur, un titre qui avait attiré mon attention parmi la liste des nominés pour le Prix Goncourt de cette année (et qui a finalement reçu le Prix Femina). J’ai dévoré en quelques jours ce récit à mi-chemin entre l’enquête journalistique et l’essai à la première personne, qui tourne en cercles concentriques autour d’un sujet bien difficile lui aussi : le féminicide. Nathacha Appanah retrace le parcours de trois femmes (dont l’une est sa version plus jeune, qu’elle tient à distance comme une photographie dont on regarde le négatif à la lumière) et s’attache à redonner un peu d’épaisseur aux victimes, qui, comme elle le dit très justement, sont souvent déshumanisées par leur mort atroce, et réduites à un nom dans les journaux.
J’ai été particulièrement frappée par son récit personnel de l’emprise, de la mémoire traumatique, qui a beaucoup résonné avec mes propres interrogations et m’a renvoyé à des moments plutôt sombre de ma vie. Je crois que, quand on a subi des choses difficiles, on cherche partout des échos et des miroirs, et pour ma part, j’entretiens soigneusement une collection intérieure de fragments de films, de séries et de phrases qui me permettent de mettre des mots et des images sur ce que j’ai vécu de mon côté (tristement terrible, tristement banal) et dont je peine encore à faire sens.
Dans ce florilège mental, on trouve entre autres la scène dans Maid où Margaret Qualley, après avoir capitulé et être revenue chez son conjoint violent, se fait engloutir par le canapé où elle est allongée ; les mots de Shirley McLaine dans The Apartment, (“The mirror… it’s broken/Yes, I know. I like it that way. Makes me look the way I feel.”) ; la première demi-heure de Sleeping with the Enemy, que je connais par coeur, où Julia Roberts échappe à son mari au péril de sa vie puis garnit de fleurs la fenêtre de sa nouvelle maison ; et aujourd’hui, cette citation de Natacha Appanah, qui écrit “L’année de mes 17 ans, je suis tombée dans un trou. J’ai glissé lentement, tout doucement, sans vraiment m’en rendre compte”. (De mon côté, j’écrivais rétrospectivement : “Allongée dans notre ancien appartement, je voyais la vie continuer à défiler autour de moi et je me sentais disparaître petit à petit, les contours de ma personne s’effaçant lentement mais sûrement, érodés par ses mensonges, ses mots tendres et ses injures.”)

De nos jours, on entend beaucoup plus parler des violences faites aux femmes, mais comme c’est le cas avec de nombreux de sujets militants qui viennent tout juste de déferler dans la sphère médiatique après des années de silence forcé, la férocité (nécessaire) de nos dénonciations laisse encore peu de place à la nuance du côté des victimes. Il faut du temps pour pouvoir amener cette nuance, et être certain.e que son expression ne portera pas préjudice à l’élan féministe, et ne démolira pas des années de travail. Pour ma part, je me retrouve souvent en prise avec cette notion de “victime”, justement, un statut que j’ai eu beaucoup de mal à apprivoiser, même après des années, même après des dizaines de discussions, même après qu’une enquête ait été ouverte par la police. Des fois, j’aime m’y glisser comme dans un costume, une seconde peau, pour lisser les événements et les réécrire sans aspérités : c’est l’histoire d’une fille qui est tombée sur le mauvais mec, pas de chance.

D’autres fois, c’est plus difficile, et j’ai besoin d’interroger le rôle que j’ai joué là-dedans, les zones d’ombres et de vulnérabilité qui m’ont menée à cette situation, la complicité passive que j’ai déployé lors de ma propre mise à mort, l’absence d’instinct de survie. Mais ce n’est pas facile de parler de tout ça quand on est encore occupée à faire reconnaître la simple existence de ces violences et leur gravité. L’imbroglio des faits et des sentiments ne correspond pas toujours au langage judiciaire, et j’ai peur d’être labellisée “mauvaise victime”, j’ai peur qu’on me dise que c’est ma faute, qu’on me retire la compassion que j’ai mis des années à accepter. J’ai souvent l’impression que le droit à la complexité est nié aux femmes, qui doivent déjà batailler pour faire émerger une réalité grossière et binaire, réussir à faire accepter des vérités pourtant évidentes. Si le monde entier ne faisait pas preuve de tant de mauvaise fois à l’égard des femmes, il y aurait peut-être de la place pour ces questionnements, mais pour l’instant, je n’ai pas l’impression que ce soit possible.

C’était du coup assez salvateur de voir Nathacha Appanah se positionner pile au niveau de cette zone d’ombre qui me travaille tant. Sans minimiser la gravité de ce qui lui était arrivé ou éprouver la moindre compassion à l’égard de son bourreau, elle réussit à ménager une petite place pour l’auto-interrogation, et même pour un peu d’amertume à son propre égard. “Je passe un temps fou à essayer de trouver une faille dans ma chute lente et inexorable” écrit-elle. Plus loin : “C’est étrange comment après la peur vient la colère envers celle que j’ai été. Où est passée l’éducation que j’ai reçue, où est passée ma capacité à réfléchir et à penser ?”. Puis, et ce passage m’émeut rien que de le recopier ici :
“Je voudrais savoir si ce genre de pouvoir d’emprise est inné, si ce genre d’ascendance est acquis, ou s’il faut être au bon endroit, au bon moment, trouver une sorte de victime idéale ? Ai-je été une victime idéale ? Oh, comme j’aurais souhaité avoir la preuve concrète et scientifique d’une magie noire que cet homme a exercé sur moi. Alors, voyez-vous, il me serait plus facile d’avoir de la compassion pour celle que j’ai été, je pourrais m’envisager comme une victime et alors je pourrais présenter cette preuve à mes parents, à mon frère, à mes amis et je leur dirais que j’ai été envoûtée. Je rêve parfois de faire le procès de cette jeune fille (…), d’identifier les graines de cette folie qui s’est emparée d’elle.”
Ai-je été une victime idéale ? C’est une question qui me hante encore la nuit, et j’étais contente de trouver, à défaut de réponses (y’en a-t-il seulement), au moins quelques pistes de réflexion dans La nuit au coeur.
Un hiver avec Claire Danes (et Diane Keaton)

J’aimerais dire que mon mois de novembre consacré aux féminicides s’est arrêté là, mais non, car ce mois-ci, j’ai aussi englouti la série The Beast In Me sur Netflix, qui raconte comment une écrivaine, ex-alcoolique, en panne d’inspiration et traumatisée par la mort de son jeune fils, se lie bien malgré elle d’amitié avec son voisin, un milliardaire imbuvable qui est aussi soupçonné du meurtre de sa femme. Portée par un duo très convaincant (Claire Danes, géniale dans le rôle d’une quinqua égocentrique et bourrée de tics nerveux, et Matthew Rhys, tout en angles pointus et en sourires terrifiants), The Beast in Me est un super thriller dont il est difficile de détourner les yeux, bien qu’on pressente la fin dès le début. Les deux premiers épisodes m’ont franchement emballée, et même si la série prend quelques détours narratifs qui m’ont un peu moins plu, c’était quand même huit chouettes épisodes aux titres hyper malins (il y en a un qui s’appelle “L’éléphant dans la pièce”, et il y a vraiment un éléphant dans la pièce… Bravo).
Ça m’a fait plaisir de retrouver Claire Danes dans un rôle plus mature, plus proche d’une Jodi Foster dans Le silence des agneaux (cette dernière est d’ailleurs productrice de la série and it shows) que des petites midinettes qu’elle incarnait au début des années 2000 (mais que j’adore aussi). Je tire aussi mon chapeau à la distribution secondaire, car j’ai adoré retrouver Brittany Snows, Hettienne Park et Jonathan Banks à l’écran (même si franchement, un huis-clos avec les deux personnages principaux m’aurait amplement suffit). Encore une fois, j’ai eu l’impression de me retrouver face aux mêmes questionnements qu’avec Penance : jusqu’où sommes nous prêt.e.s à aller pour une bonne histoire de meurtre ? Quelles images et quelles vérités sommes nous capables de tolérer pour ressentir ce rush ?

Last but not least, j’ai poursuivi mes retrouvailles avec Claire et j’ai allégé l’atmosphère grâce un premier film de Noël (et oui, on ne se refait pas) : durant la dernière semaine de novembre, j’ai lancé La famille Stone, également sur Netflix, dans l’optique d’y croiser Diane Keatons, qui nous a quittés en octobre. C’était un film qui n’a absolument aucun sens d’un point de vue scénaristique, au point que c’en est presque fascinant, mais le house porn était super, et c’est tout ce que j’attends des films de Noël, pour être honnête (ça, et une foi renouvelée en l’humanité). Je ne sais pas si La famille Stone a réussi sur ce second plan, mais Claire Danes, dans un rôle de sœur pas très girl’s girl, était en tout cas angélique . Si vous avez envie de débrancher votre cerveau et de recroiser tout le Hollywood des années 2000 sur fond de bourgeoisie bohème, foncez, c’est un délice.

Et vous, quels étaient vos coups de coeur et vos obsessions du mois de novembre ?
