Things are defrosting… le printemps arrive
Le mois de février est probablement le mois que je déteste le plus dans l’année : il fait froid, le beau temps tarde à apparaître et le jour à se lever. C’est le bout du bout de l’hiver, le moment où on n’a plus aucune réserve de chaleur pour traverser la grisaille et la brume. Entre deux films dans mon lit, en pensant à Duras, j’ai beaucoup, beaucoup réécouté cette incroyable chanson interprétée par Jeanne Moreau et sa voix envoûtante pour le film India Song :
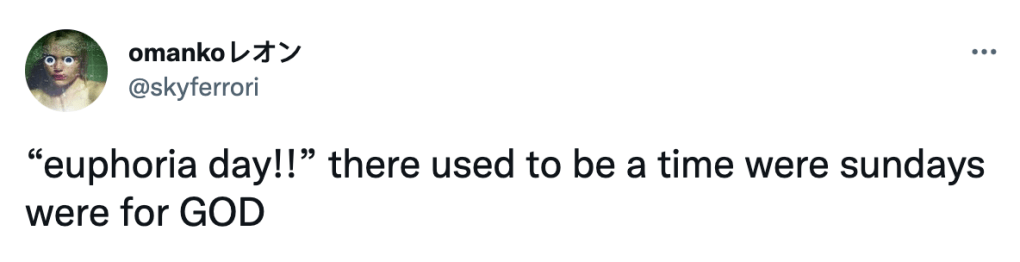
Euphoria et #FreeKesha
Comme la moitié de la planète, j’ai vécu en février au rythme des épisodes d’Euphoria (un par semaine, dispo dès le lundi en streaming !) et des péripéties de Rue, Cassie et Maddy. La saison 2 m’avait totalement conquise au premier épisode, en se surpassant en termes d’images et en semant les graines d’intrigues qui paraissaient très prometteuses ; malheureusement, l’enthousiasme fut de courte durée, chaque lundi soir apportant son lot de déception et surtout l’inlassable question “Quand va-t-il enfin se passer quelque chose entre Lexi et Fez ?”. Regarder une série semaine après semaine à l’heure du streaming illimité a constitué une vraie rupture dans mes habitudes de consommation (alors que j’ai pourtant grandi avec les feuilletons hebdomadaires à la télé… Netflix m’a brainwashée) : l’attente entre chaque épisode, dans le cas d’Euphoria, m’a surtout permis de réaliser à quels points les enjeux narratifs s’amenuisaient d’épisode en épisode. Les inégalités entre les héros et héroïnes, déja bien présentes dans la saison 1, ont sérieusement empiré : où est passée Kat ? Que fait Lexi durant les 6 premiers épisodes ? Pourquoi passe-t-on autant de temps avec les personnages les plus abusifs (Cal, Nate et… Rue), alors que les personnages féminins les plus intéressants sont réduits à quelques lignes et à un arc narratif grossier ?
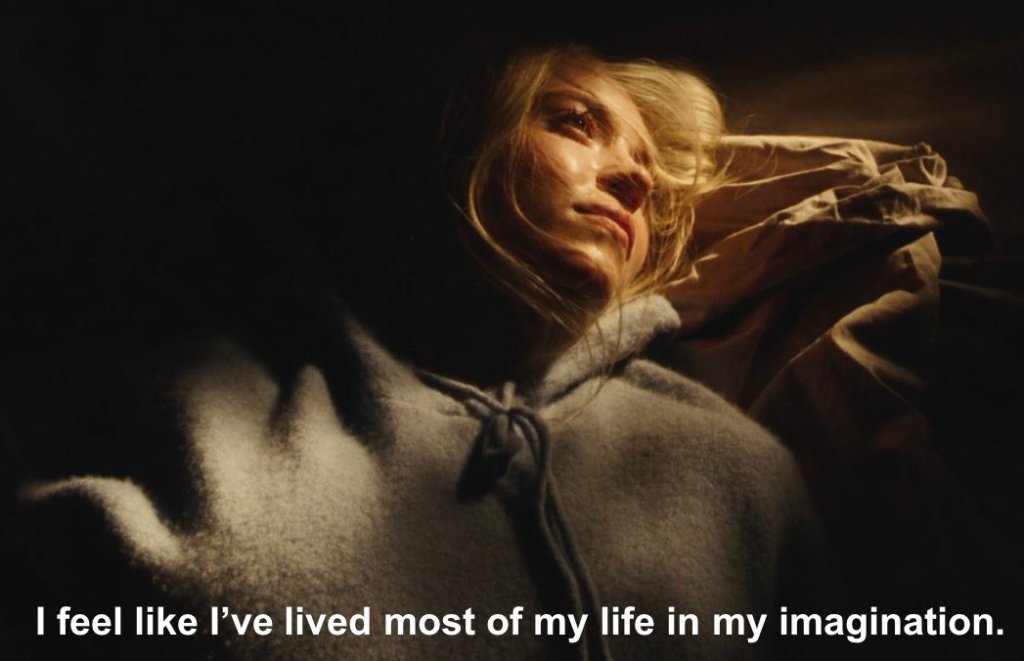
L’évolution de Cassie, en particulier, m’a laissée perplexe. Alors qu’elle représentait un contrepoint nécessaire et touchant à l’assurance névrosée de Maddy, la façon dont ses failles sont traitées à l’écran dans cette deuxième saison empêche toute forme d’empathie réelle pour le personnage, et la direction de l’actrice y est pour beaucoup. Pourquoi tourner en ridicule une souffrance avec laquelle beaucoup d’adolescent.E.s sont en prise : l’addiction au regard masculin et le désir d’être aiméE ? Cassie continue d’être le personnage auquel je m’identifie le plus et pour lequel j’ai le plus de tendresse, peut-être encore plus maintenant qu’elle a commis tous ces faux pas, et je suis vraiment en colère contre Sam Levinson et la façon dont il la transforme en gag (sans oublier que Syndey Sweeney s’est exprimée sur son malaise face à toutes les scènes de nu)..

Heureusement, deux choses ont contribué à rehausser la saison à mes yeux : l’épisode 7, consacré à la pièce de Lexi (et cette réplique de Fez en costume, qui contient tellement de tendresse, de vulnérabilité et d’espoir que c’est en trop pour mon coeur, vous savez de laquelle je parle) et… la bande-son. Plus qu’aucun album, ce mois-ci, je me suis réveillée et je me suis endormie au son de la playlist d’Euphoria. La chanson originale que j’ai préféré est celle de Tove Lo, une artiste que j’adore déja en général, et que j’ai été super heureuse de retrouver dans la série avec un morceau poignant et électrisant comme elle en a le secret, mais j’ai aussi savouré les compositions de Labyrinth (décidément, il porte la saison sur ses épaules) et les géniales trouvailles de la music supervisor du show, Jen Malone.

Février c’était aussi la sortie de Slut Pop de Kim Petras… À première vue, c’est à la fois les strass qu’on pose sur nos paupières avant d’aller danser, les douze martini du hot girl summer, le célibat à la Saint-Valentin et notre meilleure pote au téléphone toute la nuit ; un album tellement excellent et énergisant qu’on ne peut que dire merci à Kim de pousser le vice un peu plus loin et de militer cette pop décomplexée et fun. Malheureusement, c’est aussi un projet de Dr Luke, qui a intégralement produit l’album ; à l’heure où Kesha n’a toujours pas gagné sa bataille juridique contre lui, c’est tout de suite beaucoup plus dur de chanter les paroles de “They wanna fuck” ou “Treat me like a slut”, deux morceaux sur lequel il est crédité comme co-writer. Surfant sur la libération incarnée par Kim Petras, une artiste trans qui parle de sex positivity, le succès de l’album questionne l’impunité dont jouissent encore et toujours les hommes de l’industrie musicale, qui continuent de tirer les ficelles dans l’ombre et de s’enrichir sur le dos des femmes dont ils exploitent l’empowerment, comme en parle très bien Tómas Mier dans cet article pour Rolling Stones.

Du cinéma d’Ana Lily Amirpour
En février, c’était aussi la rétrospective de Gerardmer à Paris ! L’occasion de rattraper les films en compétition à la Cinémathèque le temps d’un week-end, et de découvrir plein de super films de genre. Après avoir vu La Abuela à La Clef (occupez le ciné!), j’ai découvert The Innocents d’Eskil Vogt, qui m’a laissée glacée, les doigts agrippés à mon siège. Le réalisateur réussit un double tour de force en mettant en scène une horreur insidieuse particulièrement impitoyable et en filmant des enfants. La réussite du film tient selon moi dans le fait que cette cruauté sans borne offre un miroir plutôt juste du monde de l’enfance, un univers régi par la loi du plus fort et des règles tacites qui échappent au regard adulte.

Le film qui m’a le plus marquée cependant reste le nouveau (et tant attendu) film de la seule, l’unique et l’inimitable Ana Lily Amirpour, la réalisatrice irano-américaine qui signait en 2014 l’envoûtant A girl walks home alone at night. En rédigeant ma critique pour son troisième long-métrage, Mona Lisa and the Blood Moon, (bientôt en ligne!), j’ai réalisé que je n’avais jamais vu son deuxième projet, The Bad Batch, dont j’avais vaguement entendu parler, mais qui n’a pas du tout suscité le même enthousiasme que A girl. Le pitch est pourtant ultra juicy puisque le film parle à la fois de cannibalisme, de désir, de désert américain et de communautés marginales, le tout porté par le duo exceptionnel de Suki Waterhouse (un bras et une jambe en moins) et Jason Momoa (mutique, comme d’hab). Le voir juste après Mona Lisa and The Blood Moon m’a vraiment permis de me plonger dans les thématiques ritournelles de l’œuvre d’Amirpour, qui réussit toujours à entremêler l’amour, le désir et la mort avec poésie et férocité à la fois. Les trois films sont extrêmement différents les uns des autres, autant dans leurs esthétiques que leurs histoires, et pourtant, un fil conducteur subsiste et nous entraîne des rues imaginaires de Bad City aux strip-clubs de La Nouvelle Orléans en passant par le Texas sauvage, et c’est étrangement émouvant.

Une bonne raison de détester davantage Marguerite Duras ?
Au cinéma, j’ai découvert le très beau Vous ne désirez que moi (un de ces titres qu’on n’oublie pas) et son drôle de format, qui mêle une longue conversation devant la caméra tandis que le jour décline, des bribes de souvenirs sur pellicule et quelques images d’archives. On ne vas pas se mentir, Vous ne désirez que moi est un peu film d’initié : il parlera surtout aux littéraires familier.ère.s de l’oeuvre de Duras, aux lecteurs.trices dans l’âme, aux amoureux.euses des mots justes, en ce qu’il traite avant tout de la fascination d’un homme pour une autrice. Je ne suis pas une grande fan de Duras, ayant seulement lu L’Amant et n’ayant pas été totalement convaincue. Son écriture est indéniablement d’une grande beauté, mais c’est aussi difficile de lire des récits du colonialisme écrits par une femme blanche totalement aveugle à ses propres préjugés. Marguerite Duras a toujours dénoncé l’hypocrisie du colonialisme, certes, mais cela ne l’empêche pas d’avoir totalement intégré la vision exotisante de l’autre qui prédominait à l’époque. Le personnage m’était déja peu sympathique, mais en découvrant le pan de sa vie personnelle que présente Vous ne désirez que moi, j’ai décidé que je la détestais bel et bien. Le film explore sa relation avec un fan devenu son amant, le jeune Yann Andréa, brillamment interprété par Swann Arlaud (<3), à partir des enregistrements que le premier avait réalisé avec son amie journaliste Michèle Manceaux (Emmanuelle Devos, très chouette aussi), et dans lesquels il se confie à propos de son amour pour Duras. Qualifiée de “passion destructrice” et de “relation inégale” par Le Monde (en France, on aime l’euphémisme), cette histoire d’amour est surtout une histoire d’abus et d’emprise (l’homophobie en prime !). Malgré la chaude lumière jaune qui enveloppe le film et les acteurs, on ne peut s’empêcher d’être transi.e d’horreur par la cruauté de cette relation complètement vampirisante, qui interroge aussi la posture de l’écrivain.E et son rapport (ici extrême) au lecteur.rice.
Malgré tout, le film m’a ramenée à India song, que j’aime beaucoup, à sa musique, à sa langueur et, inévitablement, m’a donné envie de donner une chance à un autre roman de Duras : j’ai donc lu Un barrage contre le pacifique, son premier livre, qui m’a beaucoup plus séduite que L’Amant -l’écriture y est tout aussi puissante mais on sent que Duras ne s’est pas encore installée dans le style haché, très scansion, qui fût le sien par la suite, ce qui allège aussi la lecture. On y retrouve toujours les mêmes thèmes que dans l’œuvre globale de l’autrice -l’Indochine, les colonies et sa vie sociale qui tombe en miettes, la pauvreté, l’initiation de la jeune fille… C’est un roman qui vous happe et ne vous lâche pas, à la fois plein de fureur et de délicatesse.
Male gaze et abolition policière
Ce mois-ci, j’ai lu deux essais qui étaient sur ma to-read list depuis un petit moment !
Le premier s’intitule Défaire la police et est paru aux excellentes éditions Divergences (pas chères ! Engagées ! Un petit format qui tient dans une poche !) et aborde la question de l’abolition de la police sous forme de courts essais. C’était une lecture très instructive, ne serait-ce que parce que le sujet de l’abolition est encore très confidentiel en France : on parle souvent plutôt de la réforme de la police ou de réduire ses financements. Comme l’expliquent très bien les différent.e.s contributeur.trice.s du livre, la réforme ne peut être une solution sur le long terme et montre déjà beaucoup de limites ; il est tout aussi intéressant de voir plus loin et de réfléchir à ce que pourrait être une société sans police (une idée qui peut sembler absurde mais qui vaut vraiment la peine d’être explorée). Défaire la police permet de repenser non seulement l’institution policière mais aussi plus vastement les notions de justice et notre système carcéral. Pour aller plus loin, peut écouter l’excellent podcast “Abolition is for everybody”, qui se concentre surtout sur la question de la prison, mais pas que, et en français, cet épisode du Média, qui résume très bien les enjeux du débat.
Dans un autre registre, j’ai enfin lu Une femme regarde les hommes regarder les femmes de Siri Hustvedt (un titre qui plairait sans doute à Amirpour), qu’Iris Brey cite notamment dans son ouvrage Le regard féminin. Si les réflexions de Hustvedt sont très justes et qu’elle soulève des pistes intéressantes concernant la façon dont une oeuvre est à la fois le produit de l’artiste qui la crée et du spectateur.trice qui la regarde -réhabilitant aussi l’idée que l’art se destine à tout le monde-, j’étais un peu moins convaincue par le format du livre, qui se compose d’une multitudes de petits chapitres aux thèmes variés. Finalement, il ne traite pas tellement du male gaze mais regroupe plutôt une collection de réflexions sur des sujets assez divers : elle passe ainsi de Louise Bourgeois à une exposition sur Mapplethorpe organisée par Almodovar en passant par la signification psychologique des cheveux ou la critique d’une conférence de Susan Sontag… J’ai eu un peu du mal à y trouver mon compte. Hustvedt parle à la première personne pour exposer son ressenti d’autrice très cultivée, et brasse beaucoup de références universitaires aux beaux arts et à la philosophie, ce qui rend son livre quelque peu difficile d’accès (et comme le disait très justement mon amie Éliz, ça manque d’images : c’est quand même fou ces pages et ces pages de description sans aucune illustration !). Ce sont aussi des critiques que l’on peut faire à Brey, d’ailleurs, et c’est dommage que ces sujets, pourtant intéressants, soient encore si peu vulgarisés…
J’ai aussi aimé :
- Le roman graphique Heïdi au printemps de Marie Spénale
- La comédie horrifique The Little Shop of Horrors (la version de 1960) et ses plantes cannibales
- re-regarder la saison 1 de Lizzie McGuire

On se quitte sur le morceau que j’ai écouté en boucle à la fin du mois pour me réchauffer, inspirée par le rock mélancolique des films d’Amirpour, et que vous connaissez déjà :
Ever though of calling when you had a few ?
Cause I always do
Baby we both know that nights were mainly made
To say the things you can’t say tomorrow day…
(heureusement les boîtes réouvrent)
